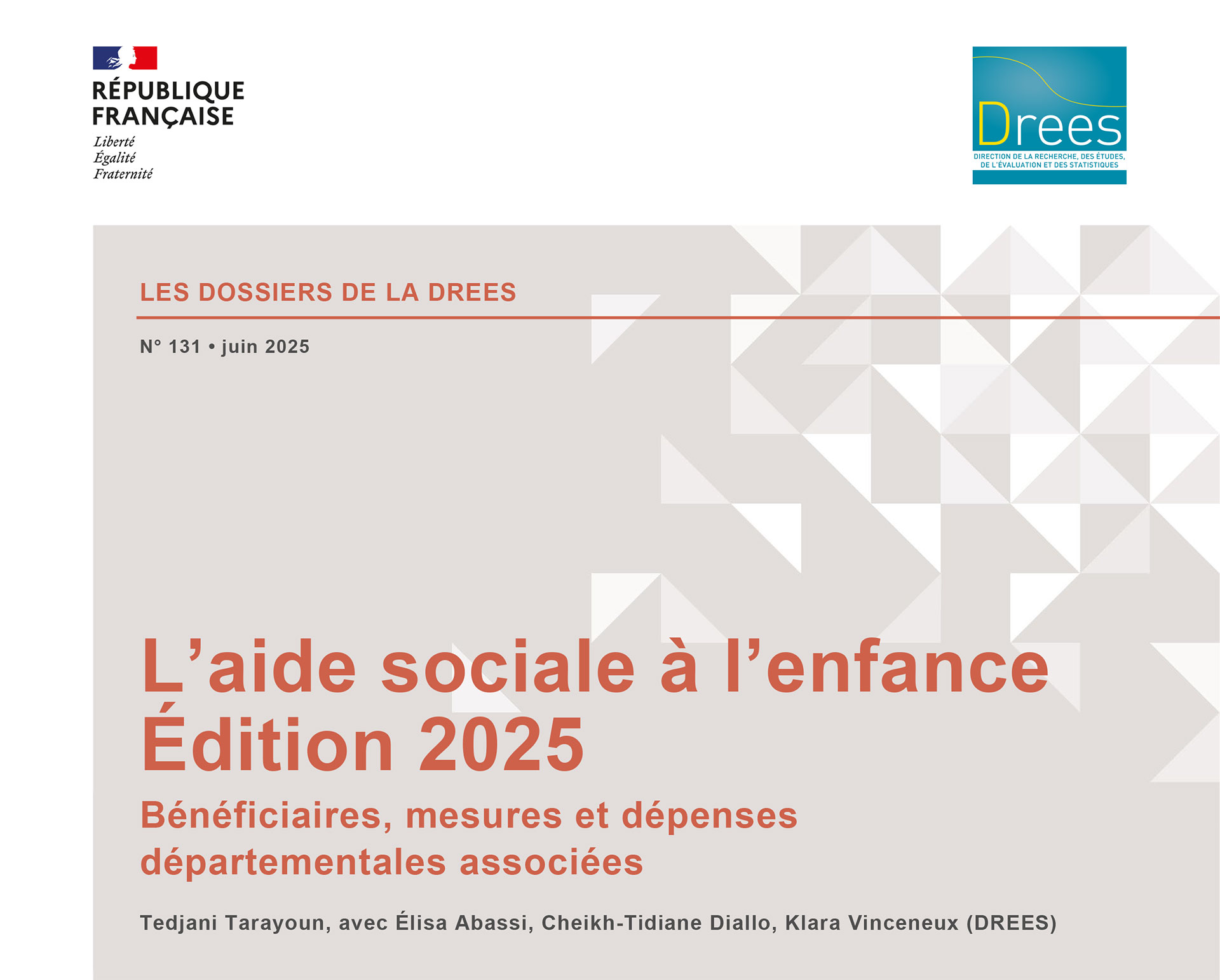Face aux défis de la protection de l’enfance : des données nationales aux réalités locales
La publication du rapport 2025 de la DREES sur l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) éclaire les grandes dynamiques à l’œuvre dans les politiques de protection des enfants en France. Avec près de 400 000 jeunes accompagnés chaque année, dont une part croissante de mineurs non accompagnés (MNA), l’ASE se transforme sous l’effet d’évolutions sociales, migratoires et juridiques majeures.
Dans ce contexte national, l’action de terrain portée par l’Association PAJE dans les Alpes-Maritimes illustre concrètement la manière dont ces enjeux se traduisent au niveau local, au plus près des publics les plus vulnérables.
Un public de plus en plus nombreux et diversifié
Alors que le rapport DREES souligne une hausse de +29 % des mesures ASE en dix ans et une montée en puissance des jeunes majeurs dans les dispositifs, PAJE accompagne chaque année plusieurs centaines de mineurs et jeunes majeurs en protection de l’enfance, au sein de ses MECS, dispositifs d’hébergement autonome ou structures éducatives.
Ces jeunes sont confrontés à des problématiques multiples : ruptures familiales, isolement, déscolarisation, troubles psychiques, mais aussi exil, errance ou perte de repères. Ils nécessitent un accompagnement global, structuré et coordonné, fondé sur la confiance, la régularité, et une attention constante à leur singularité.
Le Pôle Mineurs Non Accompagnés : réponse d’un territoire à un défi national
En 2024, le Pôle MNA de PAJE a accompagné 403 jeunes.
Ce chiffre reflète l’évolution nationale observée dans le rapport DREES : les MNA représentent désormais 21 % des jeunes confiés à l’ASE, avec des parcours marqués par l’instabilité, les vulnérabilités multiples, mais aussi une volonté forte d’intégration.
Chez PAJE, les MNA bénéficient :
- d’un accès au logement (foyers, appartements en diffus, lieux dédiés aux jeunes filles),
- d’un accompagnement administratif (demandes de titre de séjour, documents d’état civil),
- de parcours linguistiques adaptés (ateliers FLI internes),
- d’un suivi éducatif, psychologique et médical,
- et d’un soutien à l’insertion professionnelle, en lien avec des partenaires comme France Travail, la Mission locale ou Pajavenir.
Une action ancrée, évolutive et partenariale
L’approche de PAJE repose sur une conviction forte : l’efficacité de la protection de l’enfance dépend de sa capacité à s’adapter aux besoins réels des jeunes. Cela suppose une souplesse dans les réponses, une coordination étroite avec les institutions (Département, Éducation nationale, Préfecture, Justice, Santé), et une éthique professionnelle portée par les équipes sur le terrain.
Les professionnels de PAJE — éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, psychologues, coordinateurs — font preuve d’un engagement constant, malgré la complexité croissante des situations et les tensions du secteur. Leur expertise permet de conjuguer protection, accompagnement vers l’autonomie et reconstruction personnelle.
Une responsabilité collective
Les chiffres du rapport DREES appellent une mobilisation renforcée de l’ensemble des acteurs publics et associatifs. L’association PAJE y répond chaque jour, en continuant d’innover dans ses pratiques, de professionnaliser ses équipes, et de porter un modèle de protection de l’enfance fondé sur la proximité, la bienveillance et la transformation sociale.